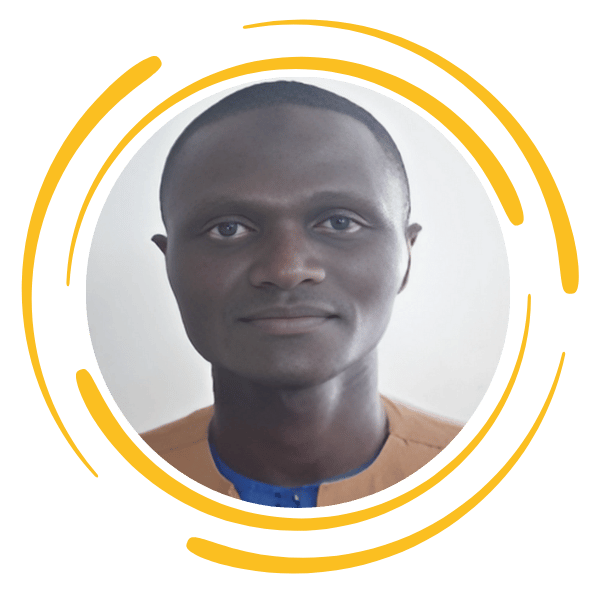Biographie de l’auteur
Doctorant à l’École Doctorale Espaces Sociétés Humanités (ED-ESH) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), je me spécialise en évaluation d’impact des politiques de développement. J’enseigne à l’UASZ, à l’Université Amadou Mahtar Mbow, ainsi qu’à l’ENSEPT/UCAD.
Je suis également assistant à l’École française François Rabelais de Ziguinchor.
J’ai participé au colloque 2024 du Laboratoire de Recherche en Sciences Économiques et Sociales (LARSES) et je suis membre de la Cellule Interne d’Assurance Qualité (CIAQ) de l’UAS.
Résumé de la contribution
Ce papier souligne l’importance d’une gestion participative et inclusive des biens communs, notamment l’eau, dans les activités agricoles impliquant des infrastructures hydrauliques avec une participation institutionnelle de l’État. La mobilisation spontanée d’une communauté de producteurs regroupée en coopérative favorise la mutualisation des compétences et compense les limites étatiques dans la gestion des projets publics. La création de services innovants liés à l’eau répond mieux aux exigences des usagers via des innovations sociales, le barrage jouant un rôle central. Une gestion coordonnée incluant les aménagements des vallées et bas-fonds permet d’optimiser les rendements rizicoles.
Face au changement climatique, ces ouvrages hydroagricoles assurent une meilleure gestion de l’eau en contexte de pluviométrie irrégulière et garantissent une répartition équitable de la ressource. Le comité des villageois propose ainsi une innovation sociale visant à accroître la production agricole.
Deux recommandations politiques sont avancées pour intensifier la production de riz :
- Adopter une planification intégrée et participative des ressources en eau pour renforcer l’adhésion des paysans à la coopérative et mutualiser les moyens.
- Transférer la maintenance des équipements et la gestion des parcelles de l’État vers la coopérative, accompagnée d’une formation adaptée aux besoins agricoles locaux.
Les limites du travail résident dans l’incapacité à dissocier les impacts spécifiques des différentes composantes de l’innovation sociale (gestion de l’eau, accès aux semences tolérantes à la salinité, accès aux engrais) à cause de données partielles, ainsi que dans l’utilisation d’une méthode économétrique (variable instrumentale pour un traitement binaire) moins précise pour traiter un mode d’adhésion multinomial.
Pour la recherche future, il est recommandé de collecter des données distinguant chaque aspect de l’innovation sociale et de considérer l’effet de la distance entre barrage et aménagements terminaux sur la gestion de l’eau.