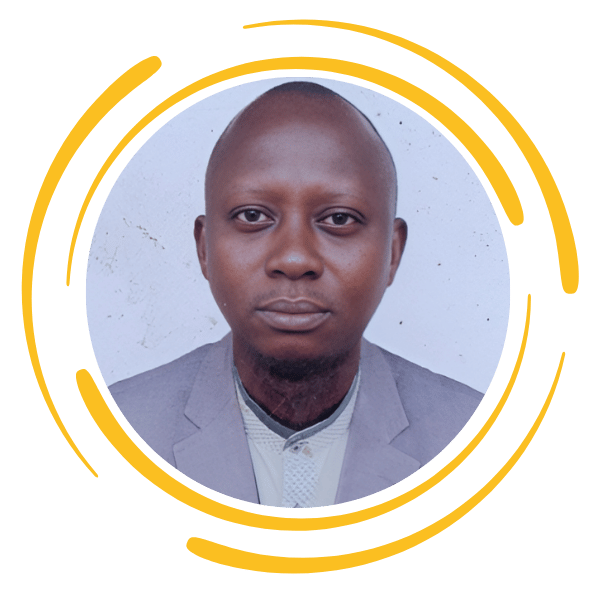Biographie de l’auteur
Docteur Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO est Maître de Conférences du CAMES et Enseignant-Chercheur à l’Université de Parakou, spécialisé en sociologie du développement et gouvernance locale. Il détient un doctorat et plusieurs diplômes en sociologie, développement urbain et sciences sociales.
Il a occupé divers postes dans l’enseignement, la gestion et la communication. Auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, il a encadré de nombreux mémoires et thèses.
Résumé de la contribution
Cette recherche menée sur les perceptions et les stratégies d’adaptation des Mokolé de Kandi face à l’harmattan et aux changements climatiques a permis de mettre en lumière des dynamiques complexes et enrichissantes au sein de cette communauté. Les résultats montrent que l’harmattan est perçu comme un phénomène naturel dont l’intensité et la prévisibilité sont de plus en plus influencées par les changements climatiques. Ces perceptions varient en fonction des groupes d’âge et des expériences, révélant une compréhension évolutive de l’harmattan. Les impacts de l’harmattan se manifestent à plusieurs niveaux, touchant la santé, l’économie, et la vie sociale. Des affections respiratoires, des irritations oculaires et des perturbations dans les activités agricoles et pastorales figurent parmi les principaux défis. Les stratégies d’adaptation observées vont des pratiques traditionnelles, telles que l’utilisation de pommades à base de beurre de karité et les regroupements autour du feu, à l’adoption de méthodes modernes comme l’usage de vêtements protecteurs. Cette combinaison de savoirs traditionnels et de solutions innovantes témoigne de la capacité de résilience de la communauté.
La recherche a également révélé l’importance des leaders communautaires dans la médiation et la gestion des réponses collectives. Ces leaders assurent la transmission des savoirs et l’organisation des discussions pour préparer la communauté aux défis de l’harmattan. Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de participation inclusive, où l’implication des femmes et des jeunes dans la prise de décision peut encore être renforcée. En comparant ces résultats aux études antérieures, il apparaît que les Mokolé s’inscrivent dans un processus d’adaptation continue, motivé par la nécessité et enrichi par les échanges intergénérationnels. Cette dynamique de résilience collective souligne l’importance de soutenir la communauté par des initiatives de sensibilisation et des politiques adaptées qui valorisent les savoirs endogènes tout en intégrant des solutions modernes. On peut retenir que la communauté Mokolé de Kandi incarne un exemple de résilience face aux défis climatiques grâce à un ancrage profond dans ses traditions et une ouverture croissante aux pratiques contemporaines. Pour renforcer cette capacité d’adaptation, il est crucial de promouvoir une éducation environnementale et un soutien aux initiatives communautaires qui incluent toutes les composantes de la société, afin de garantir une réponse efficace et durable aux impacts climatiques présents et futurs.